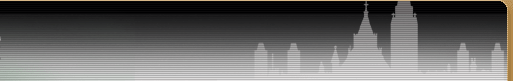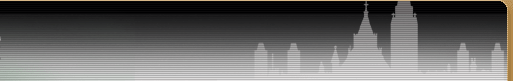|
PDF
Edward McWhinney
Le 4 décembre 2008, la gouverneure
générale Michaëlle Jean a rencontré le premier ministre Stephen Harper à Ottawa,
à la demande de celui-ci, après avoir interrompu la veille une visite officielle
dans trois pays d’Europe centrale. La réunion s’est tenue en privé et,
conformément à un usage de longue date, sans donner lieu à un procès-verbal
officiel. La gouverneure générale a accédé à la demande de prorogation immédiate
du Parlement et prévu, comme l’avait indiqué publiquement le premier ministre,
que la Chambre des communes reprendrait ses travaux le 26 janvier 2009. Ces
événements ont soulevé diverses questions sur le rôle du gouverneur général, qui
sont examinées dans le présent article.
La fonction de gouverneur général s’inscrit
dans l’héritage constitutionnel « reçu » au Canada, ce qu’on appelle aujourd’hui
le modèle de Westminster, ou modèle britannique, fondé sur le dualisme de
l’exécutif (chef d’État nominal et chef de gouvernement). Si l’on excepte la
Grande-Bretagne, ce sont dans les « anciens » dominions, le Canada et
l’Australie, que le modèle a été le mieux préservé. Il a aussi été reproduit —
et continue de fonctionner, nourri par une certaine capacité d’imagination et
d’innovation pragmatique — dans des pays qui ont déjà été ou sont encore membres
du Commonwealth. L’Irlande et l’Inde, par exemple, l’ont adopté librement, de
préférence à d’autres types d’exécutif, après une étude poussée des modèles en
vigueur aux États-Unis et en Europe continentale.
L’essentiel du droit qui régit la
conduite du gouverneur général du Canada se trouve non pas dans l’Acte
de l’Amérique du Nord britannique de 1867 (renommée
Loi constitutionnelle en
1982), mais bien dans les usages institutionnels non codifiés de la
Grande-Bretagne et vieux de plusieurs siècles, à savoir les conventions
constitutionnelles. Peuvent s’y ajouter, de nos jours, les pratiques d’autres
pays du Commonwealth qui ont gardé le modèle britannique, mais qui ont eu
beaucoup plus d’occasions que la Grande-Bretagne, ou même le Canada, d’adapter
par tâtonnements des formes et des processus constitutionnels séculaires, voire
archaïques, aux conditions et aux besoins différents de la société
contemporaine. Il aurait été possible, et certes avisé, à partir de 1867 et
surtout après l’adoption du Statut de Westminster
de 1931, de codifier la charge de gouverneur général et d’essayer de définir la
nature et les limites prudentes de ses pouvoirs discrétionnaires,
particulièrement en ce qui concerne le pouvoir d’octroyer, de refuser ou de
révoquer le mandat de gouverner. Malgré leurs origines juridico-historiques
autres que le système britannique, certains pays d’Europe continentale,
caractérisés par un dualisme semblable de l’exécutif, ont justement procédé à
une codification dans leur nouveau régime constitutionnel de l’après-Seconde
Guerre mondiale, ce qui a permis de réduire les risques de voir la population
accuser le chef d’État de partisanerie politique. Au Canada, l’inaction
s’explique en partie par l’inertie politique présente dans les pays qui ne
traversent pas dans l’immédiat de grave crise politique, sociale ou économique
pouvant amener le public à réclamer des changements constitutionnels en
profondeur ou carrément une nouvelle constitution. Les rares modifications
ponctuelles apportées à la Constitution ces dernières années, comme les
dispositions de la Loi électorale du Canada
adoptées en 2007 pour instaurer des élections à date fixe1, ont
parfois été incomprises quant à leur objet et à leur raison d’être, malgré un
libellé législatif très clair et explicite. La modification de 2007 ne confère,
en réalité, aucun pouvoir constitutionnel supplémentaire au gouverneur général,
dont les pouvoirs discrétionnaires (existant aujourd’hui, mais incluant le
pouvoir de dissoudre le Parlement) sont expressément « sauvegardés » par la loi.
Un moyen de conférer des pouvoirs, sinon
juridiques du moins politiques, au gouverneur général serait d’attribuer à la
charge une légitimité supplémentaire en la soumettant à un scrutin direct ou
indirect. Jusqu’au Statut de Westminster
en 1931, le gouverneur général est demeuré un dignitaire impérial choisi par le
gouvernement britannique et responsable devant lui. En 1916, le premier ministre
conservateur, sir Robert Borden, a vivement protesté contre le fait que les
autorités britanniques avaient désigné le successeur du duc de Connaught sans
consulter Ottawa au préalable. À la nomination suivante, un processus de
consultation confidentielle d’Ottawa avait vu le jour. À partir des années 1930,
soit la période suivant la promulgation du Statut de
Westminster, le gouverneur général a été choisi dans
les faits par Ottawa. En outre, depuis les années 1950, tant le mode de
nomination que le choix même relèvent entièrement d’Ottawa (sauf pour la
nomination officielle par la reine, après coup). (En 1930, le roi George V a
essayé d’opposer son veto au choix du premier ressortissant australien au poste
de gouverneur général, mais il a capitulé devant la résistance du premier
ministre travailliste australien.) Depuis, il n’y a pas eu de retour en arrière
possible. L’élection du gouverneur général aurait-elle un effet positif? Les
exemples qui viennent de l’étranger illustrent trop souvent les caractéristiques
propres à la société et à la culture politique du pays en cause. L’Irlande a le
processus le plus ouvert et le plus démocratique, à savoir l’élection du chef
d’État au suffrage universel; mais en Irlande, peut-être en raison de l’exemple
donné par les tout premiers titulaires du poste — De Valera a exercé la charge
pendant deux mandats complets jusqu’au début de la quatre-vingt-dizaine —, le
chef d’État a fait preuve d’une retenue édifiante dans l’exercice de ses
pouvoirs en partie codifiés et en partie fondés sur les conventions
constitutionnelles. Les deux derniers présidents irlandais, Mary Robinson et
Mary McAleese, sont des femmes et d’éminentes juristes. Mme McAleese,
la titulaire actuelle, a été réélue sans opposition pour un deuxième mandat. En
Inde, le président est élu suivant un mode de scrutin plus compliqué, indirect
et régional. Compte tenu des résultats électoraux des dernières décennies qui,
fragmentés par les multiples partis, n’ont pas dégagé de nette majorité, il a
souvent pris l’initiative d’exercer ses pouvoirs discrétionnaires, mais sans
donner l’impression qu’il cherchait à étendre son influence ou sans prêter le
flanc à la critique populaire. Chez nous, la canadianisation de la charge, du
moins symboliquement, par la nomination de Vincent Massey et l’absence de
véritable possibilité de faire usage ou d’abuser des pouvoirs résiduels depuis
l’affaire King-Byng en 1926 ont facilité la nomination de personnes au statut
différent : autrefois réservée aux militaires et aux juristes, la charge est
maintenant occupée par des hommes et des femmes qui peuvent incarner aux yeux de
la population le nouveau pluriculturalisme de la société canadienne. Soit dit en
passant, la désignation successive de deux femmes respectées et appréciées en
Irlande ces dernières années et la nomination au Canada des deuxième et
troisième femmes chefs d’État ne sont pas passées inaperçues dans les autres
pays du Commonwealth et ont apparemment influencé l’Australie dans le choix
récent de la première femme au poste de gouverneur général. Les anciens et
actuels chefs d’État du Commonwealth se livrent à des échanges de vues directs
et officieux sur ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire dans l’exercice
de leur fonction la plus politiquement délicate du modèle britannique : la
formation et le démantèlement des gouvernements par l’octroi, le refus ou la
révocation du mandat de gouverner. Ils forment ainsi un « collège invisible » de
constitutionnalistes en exercice; si certains, comme en Irlande et
occasionnellement au Canada, sont des juristes, nombre d’entre eux ont été
formés pour une profession ou une vocation complètement différente. Ils ont en
commun la perspective de devoir affronter dans le feu de l’action des situations
concrètes très délicates sur le plan politique. On dit que même la reine a
parfois tiré parti des mariages dans la famille royale ou de cérémonies
analogues pour transmettre de façon informelle son expérience pratique, acquise
pendant près de six décennies de contacts avec douze premiers ministres de
partis très différents, à commencer par Winston Churchill. La reine jouit des
avantages considérables que lui procure un mandat à vie, par rapport à d’autres
chefs d’État, nommés ou élus, qui n’exerceront leur charge que pendant cinq ou
six ans.
Le paramètre juridico-constitutionnel de la
réunion du 4 décembre 2008
Les événements qui se sont succédé rapidement
à la fin novembre et au début décembre 2008 dans les couloirs de la Chambre des
communes à Ottawa, puis de plus en plus devant les médias et la population,
comportaient deux paramètres distincts : un élément juridico-constitutionnel à
proprement parler et un élément politico-constitutionnel. Le premier a pu être
établi et défini facilement et rapidement, après quoi, paradoxalement, l’élément
politico-constitutionnel semble s’être évanoui de lui-même.
Le 4 décembre 2008, la réunion bilatérale à
huis clos qui s’est tenue entre le premier ministre et la gouverneure générale
(conférence constitutionnelle officielle entre le chef d’État et le chef de
gouvernement) a porté sur une seule question, la prorogation du Parlement.
L’acceptation de la demande de prorogation a mis fin aux séances des deux
chambres du Parlement et a automatiquement suspendu tous les travaux qu’elles
avaient entrepris.
La prorogation est une notion juridique mais
aussi un usage du droit procédural qui fait partie de l’héritage « reçu » au
Canada à l’époque des premiers établissements coloniaux anglais. Elle a, dans
l’histoire du droit anglais, de lointaines origines qui remontent au Moyen-Âge
et à l’équilibre constitutionnel établi pour la première fois entre le roi et
les barons de la Grande Charte. Au cours des siècles qui ont suivi, la
prorogation a continué d’évoluer par tâtonnements dans la lutte de pouvoirs
continuelle entre la Couronne et les premiers parlements. Il en est abondamment
question dans les anciens commentaires qui font autorité, surtout à compter de
la fin du XVe siècle, lorsque la guerre des Deux-Roses cessa enfin,
après un siècle de conflit, sous le règne d’Édouard IV et de son successeur,
Richard III. Sous Henri VII, le premier monarque Tudor, apparurent des
assemblées parlementaires plus représentatives et, en même temps, les rouages du
gouvernement plus centralisé et plus moderne de l’Angleterre sous cette
dynastie. La caractéristique prédominante de la prorogation de l’époque
postmédiévale est le fait qu’elle est devenue une arme puissante aux mains du
roi à l’encontre du Parlement : le roi convoquait le Parlement en vue de faire
approuver les impôts exigés pour ses guerres à l’étranger, mais, sitôt cela
fait, le prorogeait pour ne pas avoir à justifier l’utilisation des fonds et les
résultats des guerres.
Au XVIIe siècle, où les
Stuart succédèrent aux Tudor, la prorogation semblait être devenue un instrument
pratique pour mettre fin à des sessions parlementaires interminables. Le Long
Parlement, convoqué en 1641 sous Charles Ier, se déclara
« perpétuel », au dire d’un éminent observateur du XVIIIe siècle,
Priestley, en invoquant la souveraineté du Parlement. Il réussit effectivement à
traverser la guerre civile et le Protectorat et à se maintenir jusqu’à la veille
de la Restauration en 1660 sous Charles II, pour être remplacé par un parlement
qui le surpassa presque par sa longévité. À l’avènement de la Glorieuse
Révolution en 1688, le problème de la longévité du Parlement parut avoir été
résolu grâce à une loi générale, la Triennial Act
de 1694, qui fut édictée sous le règne de Guillaume et Marie Stuart pour limiter
le mandat du Parlement à un maximum de trois ans. En 1716, cependant, sous le
premier souverain de la Maison de Hanovre, les ministres du roi firent passer
péremptoirement le mandat du Parlement de trois à sept ans non seulement pour
l’avenir, mais aussi dans l’immédiat, parce qu’ils craignaient qu’un appel à
l’électorat se révèle politiquement désastreux pour la nouvelle dynastie
allemande, peu populaire. Cette règle a subsisté jusqu’à la vaste réforme de la
Parliament Act qui fut
entreprise par le gouvernement Asquith en 1911 et eut pour effet de réduire le
mandat maximal de sept à cinq ans.
Avec les réformes législatives du début du
XVIIIe siècle, la prorogation devint plus courante : le roi accédait
à la demande du gouvernement, cette fonction étant généralement admise comme non
discrétionnaire. Il devint toutefois usuel d’indiquer, dans l’acte d’octroi
même, la période de clôture des deux chambres du Parlement. L’effet concret de
cette pratique fut atténué par un autre usage, établi à l’initiative du
gouvernement de l’époque, qui permettait de reporter ou de modifier par décret
ministériel la date initiale de convocation du Parlement inscrite dans l’acte
original. Le caractère symbolique, usuel et non discrétionnaire de l’octroi de
la prorogation à la demande du chef du gouvernement est amplement mis en
évidence dans les pratiques instituées par les « vieux » et les « nouveaux »
pays de l’Empire ou du Commonwealth qui sont dotés d’un régime constitutionnel
de type britannique.
On pourrait affirmer que le Parlement
canadien d’aujourd’hui dispose, en vertu de la Loi
constitutionnelle de 1982, et plus précisément de
l’article 44 de la partie V, intitulée « Procédure de modification de la
Constitution du Canada », des pleins pouvoirs nécessaires pour modifier ou même
abolir la prorogation, et assurément pour établir par voie législative les
conditions juridico-constitutionnelles de son octroi (y compris sa durée) et de
toute prolongation ou suspension ultérieure voulue par le gouvernement. Le fait
que le Parlement n’ait pas cherché à exercer ces pouvoirs au fil des ans donne à
penser que les gouvernements fédéraux successifs formés de différents partis
sont conscients des avantages politiques concrets que la prorogation peut leur
procurer, notamment un meilleur contrôle de leurs priorités parlementaires.
Cette procédure est nettement différente de l’ajournement, solution de rechange
beaucoup plus simple qui vise une seule chambre et met fin à la session sans
faire table rase des projets de loi déjà déposés.
Tous les précédents constitutionnels — l’usage
anglais « reçu », hérité des traditions, et aussi les pratiques contemporaines,
fondées sur le modèle britannique, des pays qui ont déjà été ou sont encore
membres du Commonwealth — tendent à montrer que la gouverneure générale a tout à
fait agi dans les limites de ses attributions juridico-constitutionnelles en
accédant à la demande de prorogation du premier ministre lors de leur conférence
constitutionnelle du 4 décembre 2008. D’après les précédents juridiques, il
n’était pas nécessaire d’assortir la prorogation d’une échéance, mais il était
de notoriété publique, ce dont la gouverneure générale pouvait dûment tenir
compte dans l’exercice de ses pouvoirs, que le premier ministre avait promis de
rappeler le Parlement le 26 janvier 2009 si sa demande de prorogation était
accueillie. Cette période de prorogation d’un peu plus de sept semaines
correspondait à peu près à la tradition de la relâche parlementaire de Noël et
du Nouvel An à Ottawa, qui commence au début ou au milieu de décembre et se
termine à la fin de janvier de l’année suivante.
Le paramètre politique de la réunion du
4 décembre
Faire preuve d’économie dans l’usage du
pouvoir, constitutionnel tout autant que militaire, est un principe de
prudence : il s’agit, dans toute la mesure du possible, d’opter pour les recours
juridiques les plus modérés afin d’éviter l’escalade vers des problèmes
fondamentaux et l’affrontement possible avec d’autres institutions du même
régime gouvernemental. Une fois que la question en jeu — la prorogation du
Parlement — soumise par le premier ministre à la gouverneure générale à
l’ouverture de la conférence constitutionnelle du 4 décembre 2008 a été réglée
par l’octroi de la demande, il aurait été vain sur le plan constitutionnel
d’aborder d’autres questions pouvant faire intervenir directement les pouvoirs
de réserve de la Couronne. Ces pouvoirs auraient pu être « reçus » au Canada
avant 1867 et incorporés à l’Acte de l’Amérique du
Nord britannique. Fait plus important (puisqu’ils
reposent principalement sur les conventions et n’ont jamais été codifiés), ils
auraient pu subir l’usure ou l’érosion du temps au cours du siècle et demi
écoulé depuis 1867, sinon s’être adaptés aux besoins et aux attentes de la
société canadienne contemporaine. On pourrait soutenir qu’il serait excessif de
fonder l’espoir d’un salut (juridico- ou politico-constitutionnel) sur la
gouverneure générale en pensant qu’un titulaire de cette charge s’engagera
gratuitement dans des zones grises, délicates et dangereuses, à l’exemple de
lord Bing en 1926 ou du cas encore plus frappant de sir John Kerr, gouverneur
général de l’Australie, dans sa confrontation avec le chef de gouvernement en
1975.
Le gouverneur général du Canada n’est pas le
roi George III et ne peut pas, sur le plan constitutionnel, faire affaire
directement avec les partis d’opposition, sauf par l’intermédiaire et avec
l’aval du premier ministre. Il n’existe pas en droit constitutionnel de « parti
du roi » ou de « gouvernement en puissance » dans les partis d’opposition qui
soit prêt à prendre le pouvoir à la demande des autorités. En 2005, le chef de
l’opposition officielle (Stephen Harper) a essayé, avec les chefs des deux
autres partis d’opposition (Jack Layton et Gilles Duceppe), de persuader la
gouverneure générale de l’époque, Adrienne Clarkson, qu’ils étaient prêts à
prendre les rênes du pouvoir, mais leur demande a essuyé une rebuffade
vice-royale sobre et soigneusement étudiée. (La lettre des trois chefs de
l’opposition n’a reçu comme suite qu’un simple accusé de réception de deux
lignes d’un représentant du personnel administratif de la gouverneure générale.
Pour la petite histoire, précisons qu’il s’est posé une question de protocole et
de courtoisie, du fait que, lors d’une conférence de presse, les chefs de
l’opposition avaient divulgué aux médias le texte de leur lettre conjointe
destinée à la gouverneure générale la veille de sa communication à Rideau Hall2.)
Projet de coalition
Passons maintenant à ce qui est devenu, après
l’octroi de la prorogation, une question purement hypothétique sur le plan
juridico-constitutionnel, à savoir les tenants et aboutissants d’un
« gouvernement de substitution ». Sur ce point, il existe toutefois un précédent
canadien relativement récent qui pouvait facilement servir de modèle et qui
était certainement connu d’au moins plusieurs des principaux représentants de
l’opposition impliqués dans le projet de coalition de la fin novembre et du
début décembre 2008. Il s’agit évidemment du précédent établi par l’Ontario en
1985. Le lieutenant-gouverneur d’alors, John Black Aird, avait confié au chef de
l’opposition de l’Assemblée législative de l’Ontario, David Peterson, le mandat
de former un nouveau gouvernement (minoritaire), étant donné qu’il bénéficiait
du soutien garanti du chef du troisième parti, Bob Rae, du NPD. Ensemble, les
députés des deux partis d’opposition formaient une majorité numérique à
l’Assemblée.
Au début de 1982, M. Aird avait participé à un
séminaire pour les dix lieutenants-gouverneurs provinciaux qui s’était tenu à
Victoria, en Colombie-Britannique, à l’invitation du gouverneur général, Edward
Schreyer. Cette rencontre avait pour thème l’état actuel des pouvoirs de réserve
de la Couronne et la question de savoir dans quelle mesure ils existaient encore
au Canada, aux niveaux fédéral et provincial. Dans la communication officielle
et dans la période de questions qui a suivi, les participants ont examiné une
pratique constitutionnelle qui était récente à ce moment-là. Cette pratique
concernait le chef d’État (président) de la République de l’Inde, qui avait fait
partie de l’empire britannique des Indes et avait opté librement, après son
indépendance, pour un double exécutif de type britannique (chef d’État nominal
et chef de gouvernement). Pendant les premières décennies du nouveau régime
républicain, l’Inde a connu une succession de gouvernements majoritaires forts
dirigés d’abord par le tout premier titulaire du poste de premier ministre, le
charismatique Jawaharlal Nehru, puis, brièvement, par d’autres membres de sa
famille. À la disparition de la dynastie Nehru, dans les années 1970, on a
assisté à l’émergence de fréquents gouvernements minoritaires qui dépendaient,
pour leur survie parlementaire, du soutien des petits partis de la Chambre,
eux-mêmes représentant des philosophies politiques ou des milieux sociaux
différents. Le président (dont les prétentions à la légitimité politique et
constitutionnelle étaient d’autant plus justifiées qu’il était élu, bien
qu’indirectement) s’essaya à tenir un rôle plus dynamique pour mieux remplir son
obligation constitutionnelle première, l’existence d’un gouvernement stable
capable de s’assurer le soutien de la Chambre sur une période suffisante.
Cependant, pour que l’exercice de ses propres pouvoirs discrétionnaires dans le
domaine constitutionnel puisse être vu objectivement comme tout à fait
transparent et dénué de parti pris politique, il commença à exiger que les
groupes ou partis de la Chambre intéressés par une coalition ou une alliance
majoritaire lui garantissent par écrit, de façon claire et non équivoque, leur
appui à un éventuel nouveau gouvernement ou premier ministre. Cette pratique,
qui est apparue alors extrêmement pertinente, a été conservée par les présidents
suivants et occasionnellement mise en application lorsque le gouvernement ne
disposait pas d’une majorité absolue à la Chambre. Si elle a été aussi efficace
en Inde pour produire des gouvernements stables malgré la pluralité des petits
partis et des formations présents à l’assemblée législative, c’est sans doute
parce que ceux-ci ont tendance à prendre des engagements et des orientations de
plus longue haleine que dans les autres systèmes parlementaires de type
britannique.
Le lieutenant-gouverneur de l’Ontario,
John Aird, nommé directement par le gouvernement fédéral, avait été,
conformément aux usages politiques courants de l’époque, un important agent de
financement pour son propre parti dans la province. C’était aussi un éminent
avocat, sensible à la nécessité de prendre des décisions transparentes qui
seraient vues par le public comme dénuées de parti pris ou d’influence
politique. On peut raisonnablement supposer que M. Aird avait été inspiré par la
récente pratique de l’Inde, dont il était bien informé personnellement. En fait,
dans sa décision de 1985 qui a créé un précédent, il a exigé beaucoup plus
qu’une garantie écrite présentée de bonne foi, comme en Inde; il a insisté pour
qu’on lui donne à l’avance une garantie écrite blindée, une sorte de pacte,
précisant les chiffres nécessaires à l’obtention d’une nette majorité des voix à
la Chambre, mais aussi les modalités exhaustives et détaillées du programme
politique, social et économique concret de la nouvelle alliance à qui il
pourrait décider de confier le pouvoir. Le pacte spécifiait une durée prolongée
et spécifique (deux ans) pour cette alliance de fait. L’entente de 1985 a été
publiée au complet dans le Toronto Star
et le Globe and Mail3
et cosignée par le chef de l’opposition, David Peterson, et le chef du NPD, Bob
Rae.
À la fin novembre et au début décembre 2008, à
Ottawa, ni la classe politique à la Chambre des communes ni les médias n’ont
cherché à invoquer le précédent ontarien de 1985 comme modèle éclairé pour la
coalition projetée publiquement par les trois partis fédéraux d’opposition. Au
lieu d’un pacte unique qui associait une majorité numérique de députés à un
programme commun, le scénario d’Ottawa se fondait sur deux documents distincts :
d’abord, une alliance officielle à la Chambre entre deux des trois partis
d’opposition seulement, ce qui aurait été loin de donner une majorité numérique
de députés; ensuite, une déclaration du chef du troisième parti d’opposition,
qui aurait été annexée au premier document signé par les deux autres chefs.
La différence entre le précédente ontarien de
1985 et l’entente écrite de 2008 devient toutefois manifeste lorsqu’on examine
le détail de l’engagement politique, économique et social concret prévu au
programme législatif de la Chambre des communes par la coalition qui désirait
remplacer le gouvernement : le document signé par deux des trois partis est
vague et ne renferme pas de renseignements législatifs de fond. Sur le plan
technique, ce moyen peut s’avérer utile pour essayer de concilier des positions
inconciliables. Si l’entente de 2008 semblait suffisante, politiquement parlant,
pour rapprocher deux des trois partenaires, elle n’a pas suffi, de toute
évidence, à satisfaire le troisième parti, ce qui explique peut-être le refus de
ce dernier de souscrire lui aussi à l’entente bilatérale et son désir de faire
bande à part en se limitant à un soutien extensible. Dans les circonstances,
était-ce toutefois suffisant pour persuader la gouverneure générale, qui a pour
obligation constitutionnelle première d’assurer un gouvernement stable et de
longue durée, que l’approche envisagée pourrait générer un nouveau groupement
politique capable de fonctionner à long terme avec une majorité ferme et
continue à la Chambre?
Les limites prudentes des avis spécialisés en
droit constitutionnel
La tempête politique qui a soufflé brièvement
sur Ottawa à la fin novembre et au début décembre 2008 n’était pas, pourrait-on
dire, une crise constitutionnelle à proprement parler, mais plutôt une tentative
de prise de pouvoir au Parlement dont les paramètres juridico-constitutionnels
restrictifs ont suffi pour venir à bout des principaux acteurs politiques. Cette
situation devrait évidemment rendre le rôle constitutionnel du gouverneur
général plus facile à expliquer et à défendre, pour autant que les « règles du
jeu » restrictives soient bien comprises et respectées. La fonction des
conseillers juridiques du gouverneur général (nécessairement créée pour la
circonstance, car non prévue dans la fonction publique fédérale, et, par
tradition et par convention, non rémunérée et tenue à la confidentialité) est
d’expliquer ce qui est clairement l’usage anglais « reçu », en vigueur
aujourd’hui. Ce qui n’entre pas clairement dans cette catégorie est la zone
grise, c’est-à-dire le droit et les usages « anciens », institués et pratiqués
jadis, qui peuvent aller carrément à l’encontre des conditions et des besoins
sociétaux contemporains et même de ce qui peut être considéré de nos jours comme
juste, raisonnable ou simplement logique. C’est à ce stade que s’arrêtent la
compétence et l’expertise du conseiller constitutionnel et que le gouverneur
général entre en jeu, par défaut. Dans l’affaire de novembre et décembre 2008,
le conseiller constitutionnel pouvait affirmer de bon droit, en s’autorisant de
la multitude de précédents tirés du droit anglais séculaire ou des pratiques du
système de gouvernement britannique adoptées dans le Commonwealth moderne, que
l’octroi de la prorogation est non discrétionnaire et se fait sur la
recommandation du premier ministre. Dans un deuxième temps, il pouvait aussi
indiquer de bon droit que l’ordre du jour de la conférence constitutionnelle
bilatérale du 4 décembre 2008 avait été observé et que la séance avait été levée
dès l’acceptation de la demande de prorogation.
Pour la question bien précise du
« gouvernement de substitution » souhaité par les chefs des trois partis
d’opposition (devenue hypothétique sur le plan juridico-constitutionnel du fait
que la demande de prorogation avait été agréée), la réponse serait de nature
métajuridique, car elle repose en définitive sur une décision politique de haut
niveau, à savoir si la coalition serait capable de faire front commun pendant
une période suffisamment longue pour permettre à la gouverneure générale de
remplir son obligation constitutionnelle qui consiste à assurer en tout temps un
gouvernement stable à l’ensemble du pays. On pourrait toujours faire appel à un
politologue ou consulter les sondages d’opinion, mais, au bout du compte, le
gouverneur général (qui n’a pas besoin d’être un avocat constitutionnel) doit
juger, en se fiant sur son sens commun, les faits et les acteurs politiques en
cause et prendre une décision en conséquence. Au final, c’est le gouverneur
général qui serait tenu politiquement responsable de ce que la population
pourrait considérer comme une « mauvaise » décision et c’est lui qui en paierait
le prix, par une retraite prématurée ou par le non-renouvellement de son mandat
et par l’opprobre général qui s’ensuivrait.
Autres points relatifs à ce domaine non
spécialisé des pouvoirs constitutionnels discrétionnaires :
Premièrement, depuis l’adoption du
Second Reform Bill (du
gouvernement Disraeli) en 1867, qui a substantiellement élargi le droit de vote
de façon à rendre le système plus représentatif, les pratiques
constitutionnelles britanniques se sont maintenues : elles ont toujours permis
au premier ministre dont le gouvernement avait été renversé à la Chambre, pour
une question budgétaire ou autre jugée sérieuse, d’obtenir la dissolution du
Parlement qu’il avait demandée au chef d’État. Une conclusion pragmatique se
dégage des pratiques en vigueur depuis 1867 : laissons le peuple — l’électorat —
décider à la faveur d’élections générales, pierre de touche suprême dans un État
démocratique.
Deuxièmement, à en juger d’après les pratiques
constitutionnelles britanniques en cours depuis les années 1920, ce ne sont pas
toutes les défaites du gouvernement à la Chambre qui se font sur une « question
de confiance » et qui l’obligent à remettre sa démission ou à demander et
obtenir une dissolution. Cette pratique, innovatrice et pragmatique à l’époque,
a vu le jour durant le premier gouvernement travailliste minoritaire de Ramsay
MacDonald, en 1923 et 1924, qui a été défait pas moins de 14 fois à la Chambre.
Le premier ministre (qui avait annoncé en prenant le pouvoir que lui seul
déterminerait s’il devait se présenter devant le roi en cas de défaite) n’a pas
jugé nécessaire d’agir. Si l’on se fie à cet exemple, le premier ministre du
Canada n’aurait pas eu l’obligation constitutionnelle de demander une
dissolution à la gouverneure générale après avoir perdu un vote sur des
questions économiques en novembre 2008; parallèlement, la gouverneure générale
n’aurait pas été tenue d’accéder à une demande de dissolution. (Dans cette
hypothèse, cependant, la gouverneure générale, après avoir refusé d’accorder la
dissolution, aurait seulement pu demander au premier ministre de rester au
pouvoir en dépit d’un éventuel vote négatif à la Chambre. À moins que le premier
ministre ne donne lui-même sa démission, elle n’aurait pu, dans les formes, lui
retirer son mandat de gouverner.)
Troisièmement, la demande de prorogation qui a
été accordée à la conférence bilatérale du 4 décembre 2008 entre le chef d’État
et le chef de gouvernement correspond, dans les faits, à un précédent
conventionnel/constitutionnel pour l’avenir; on pourrait normalement s’attendre
à ce qu’une future prorogation soit assortie d’une limite de temps précise,
ainsi que de contrôles raisonnables pour régir toute décision subséquente d’un
gouvernement de modifier, de reporter ou d’annuler la limite de temps prévue
dans l’acte d’octroi de la prorogation.
Quatrièmement, dans le même ordre d’idées,
lorsque le premier ministre libéral Paul Martin a annoncé brusquement sa
démission en janvier 2006, le soir même des élections générales qui ont fait
perdre de nombreux sièges à son parti, il a écarté toute possibilité de voir au
Parlement un gouvernement libéral qui, avant de démissionner, tâterait le
terrain quant à un possible gouvernement de coalition postélectoral. Il pourrait
être bon à l’avenir que le gouverneur général envisage, comme dans le cas de la
prorogation, l’établissement d’une date limite pour la reprise des travaux
parlementaires après des élections générales. Les questions soulevées par les
trois chefs des partis d’opposition à la fin novembre 2008, plus précisément
l’opportunité d’examiner les options qui s’offrent en fait de « gouvernement de
substitution » si les élections générales n’ont pas dégagé de majorité absolue,
pourraient alors être explorées et tranchées par la nouvelle Chambre.
Notes
1. « Les élections à date fixe et les
pouvoirs du gouverneur général d’accorder la dissolution »,
Revue parlementaire canadienne,
vol. 31, no 1 (printemps 2008), p. 15. Voir aussi la
critique d’Adam Dodek, « Les élections à date fixe au Canada – Une loi à
corriger », Revue parlementaire canadienne,
vol. 32, no 1 (printemps 2009), p. 18.
2. The Governor General and the
Prime Ministers. The Making and Unmaking of Governments,
2005, p. 107 et p. 180, note 6.
3. The
Toronto Star, samedi 1er juin 1985; voir aussi
The Toronto Star,
éditorial, 29 mai 1985; The Globe and Mail,
Toronto, 29 mai 1985.
|