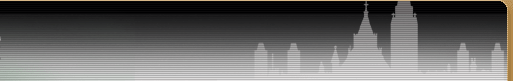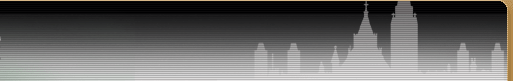|
PDF
Graham Steele, MAL
La convention relative aux affaires en instance (sub judice) est une contrainte
qu’un parlement s’impose pour garantir un équilibre raisonnable entre la
liberté d’expression des parlementaires et l’équité des procès des prévenus.
Dans le présent article, l’auteur soutient que cette convention est souvent
mal comprise. Nombreux sont ceux qui pensent que la règle interdit de parler
de toute affaire dont les tribunaux sont saisis. Il est affirmé dans l’article
qu’il s’agit là d’une interprétation trop large. Appliquée ainsi, la convention
tend à réprimer le débat parlementaire, même lorsqu’il n’y a pas le moindre
risque de nuire à l’équité d’un procès. L’auteur présente des exemples
du bon et du mauvais usage de la convention et préconise une approche plus
équilibrée afin de concilier la liberté d’expression et l’équité des procès.
Dans les parlements du Commonwealth, la convention qui impose une certaine
restriction à la discussion d’affaires dont les tribunaux sont saisis est
appelée « convention relative aux affaires en instance ». Celle-ci a pour
but est de préserver l’équilibre entre la liberté d’expression au parlement
et l’équité dans la conduite des procès. Il s’agit, dans les deux cas,
de valeurs importantes. Aucune des deux ne doit entièrement primer l’autre.
On peut invoquer six raisons principales pour lesquelles le parlement doit
éviter de laisser la convention se transformer en une restriction automatique
et trop large du débat parlementaire.
D’abord, il faut protéger assidûment la souveraineté du parlement. Il a
fallu des siècles pour établir les droits des parlements inspirés du modèle
de Westminster. Il ne faut donc pas les sacrifier à la légère. Les parlements
ne doivent jamais céder de façon automatique à quelque processus que ce
soit.
Deuxièmement, l’objet du débat parlementaire diffère de celui des instances
judiciaires. Ainsi, une enquête policière vise à établir s’il y a lieu
de porter des accusations au pénal. Si des accusations sont portées, il
ne peut y avoir condamnation que si la preuve permet de dissiper tout doute
raisonnable. Et s’il y a condamnation, une sanction est imposée pour transgression
des normes sociales. Les délibérations parlementaires sont fort différentes,
car elles portent exclusivement sur la politique d’intérêt public.
Troisièmement, il arrive souvent que le parlement et les tribunaux soient
saisis en même temps de questions importantes. « D’ailleurs, il n’est pas
rare que l’adoption d’une loi par le Parlement vise effectivement à influencer
l’issue d’affaires en instance devant les tribunaux1. »
Quatrièmement, les procédures judiciaires peuvent traîner pendant des années
et ne pas aboutir à une conclusion nette. Le parlement aurait horreur d’adopter
des règles qui auraient pour effet de paralyser le débat pendant une période
indéterminée.
Cinquièmement, il existe, d’habitude, des mesures moins radicales qui permettent
de poursuivre les débats sans porter préjudice aux procès.
Enfin, il est difficile de trouver des exemples avérés où le discours tenu
au parlement aurait influé de façon démontrable sur des instances judiciaires.
Nous devrions peut-être nous garder de trop recourir à la convention si
la menace réelle pour ces procédures se concrétise si rarement.
Ce que la convention n’est pas
Un point de départ utile est de dire ce que la convention relative aux
affaires en instance n’est pas. Il ne manque pas de raisons pour lesquelles
un parlementaire peut refuser de parler d’une affaire dont les tribunaux
sont saisis. Dans chaque cas, la raison peut être exprimée en ces termes :
« Les tribunaux sont saisis de l’affaire. Je ne peux donc pas en parler... »
Chacune de ces raisons a sa légitimité, mais aucune ne doit interdire le
débat parlementaire.
Voici quelques raisons, en dehors de la convention, qui peuvent inciter
une personne à s’abstenir de toute observation.
Il y a les contraintes stratégiques que s’imposent les parties à un procès.
Une déclaration publique peut modifier la position des parties en ce qui
concerne la stratégie d’instance, la preuve, la stratégie ou les négociations
de règlement ou les témoins. Parfois, il est plus sage de garder le silence.
Il s’agit d’un choix stratégique que les parties s’imposent elles-mêmes.
Cela n’a aucune influence sur l’autorisation ou non du débat parlementaire.
Cela veut simplement dire que, s’il y a débat, une partie (d’habitude le
gouvernement) choisit de s’abstenir d’y participer.
Il y a l’obligation déontologique des avocats envers leurs clients. Au
Canada, cette obligation est le plus souvent prévue dans le code de déontologie
régissant un barreau qui se réglemente soi-même. Les avocats sont tenus
de s’abstenir de faire des déclarations publiques sans le consentement
de leur client. Il s’agit d’une affaire qui concerne l’avocat et le client
et qui n’influe aucunement sur la question de savoir s’il y a lieu d’autoriser
un débat parlementaire.
Les avocats ont une obligation déontologique envers les tribunaux. Là encore,
cette obligation est prévue dans le code de déontologie du barreau. Il
n’y a pas si longtemps, la plupart des avocats refusaient régulièrement
de faire quelque observation que soit en dehors de la salle d’audience.
Le principe voulait que les avocats doivent présenter leurs éléments de
preuve et leur argumentation à la cour. Il était jugé irrespectueux et
indigne du processus judiciaire qu’un avocat dise quoi que ce soit aux
médias à l’extérieur de la salle d’audience. Avec le temps, ces restrictions
d’ordre éthique se sont assouplies. Il arrive maintenant fréquemment que
des avocats s’adressent aux médias. Ils conservent néanmoins l’obligation
déontologique d’être justes, exacts, et respectueux du tribunal. Cette
restriction constitue une obligation déontologique des avocats, qui doivent
faire respecter l’administration de la justice. Elle n’a aucune incidence
sur l’autorisation d’un débat parlementaire.
Un usage parlementaire veut qu’on ne puisse contraindre un ministre à répondre
à une question. Ce droit parlementaire de garder le silence s’applique
à tout moment et pour tous les sujets, que les tribunaux soient saisis
d’une affaire ou non. Là encore, il n’y a aucune incidence sur l’autorisation
d’un débat parlementaire.
Il y encore des limites d’ordre pratique : il est possible que d’autres
moyens que le parlement soient mieux adaptés pour obtenir de l’information
sur les faits. Il est fort courant qu’une question d’intérêt public fasse
l’objet d’une enquête policière, publique ou interne, d’une vérification
ou d’un ensemble de ces divers éléments. D’après mon expérience, ces processus
réussissent habituellement mieux à cerner les faits qu’un comité parlementaire,
bien que chacun ait un objectif, des moyens et des échéanciers différents.
Le parlement peut parfois croire que ses propres enquêtes et débats seront
plus efficaces s’il attend que ces autres démarches aient suivi leur cours
ou soient, au moins, bien avancées. Mais il s’agit là d’un conseil dicté
par la prudence. Il n’y a aucune incidence sur le bien-fondé ou non d’un
débat parlementaire.
Il y a le droit juridique de chacun contre l’auto-incrimination. Le paragraphe
11c) de la Charte des droits dit que « tout inculpé a le droit [...] de me
pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée
contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche ». Par ailleurs, l’article
13 dit : « Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne
ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures... » Aucun de
ces motifs ne peut justifier que quiconque refuse de s’exprimer à l’intérieur
du parlement (dans le cas d’un parlementaire) ou de répondre au parlement
(dans le cas d’un témoin qui comparaît devant un comité). Même en l’absence
de la protection de la Charte, l’immunité et le privilège parlementaires
font en sorte que rien de ce qui est dit au parlement ne peut servir dans
quelque autre instance. Le droit de ne pas s’incriminer n’a donc aucune
incidence sur l’autorisation d’un débat parlementaire.
Il y a, enfin, la protection garantie par la loi sur les renseignements
personnels qui (entre autres choses) empêche les ministres de discuter
de cas particuliers en public.
Lorsque des parlementaires sont motivés par l’une ou l’autre de ces raisons,
ils peuvent sembler invoquer la convention relative aux affaires en instance
ou peuvent être convaincus qu’ils le font, en disant : « Je ne peux parler
d’une affaire dont les tribunaux sont saisis. » Mais il nous faut éviter
la confusion. Ce que le député veut peut-être dire en fait, c’est : « Je
ne veux pas parler de cette question. » C’est bien autre chose.
Ce qu’est la convention
Toute discussion portant sur la convention relative aux affaires en instance
au Canada doit débuter par le premier rapport du Comité spécial de la Chambre
des communes sur les droits et immunités des députés, publié en 19772.
Trente ans plus tard, il s’agit toujours de l’étude canadienne du sujet
qui est la meilleure et la plus réfléchie.
La majeure partie du rapport de ce comité spécial est consacrée à une étude
approfondie des précédents. Les conclusions de fond se trouvent aux paragraphes
21 à 24, qui peuvent se résumer ainsi :
-
La justification de la convention n’a pas été établie au-delà de tout doute.
La liberté de la Chambre ne devrait pas être restreinte par une convention
dont l’existence n’est pas même totalement justifiée (paragraphe 22).
-
La seule raison qu’on puisse invoquer pour la convention est le souci d’éviter
de nuire à des instances judiciaires (paragraphe 21).
-
Il est fort peu probable que les juges puissent être influencés par ce
qui se dit au Parlement. La convention vise donc à protéger les jurés et
les témoins contre les influences indues (paragraphe 21).
-
Le préjudice est le plus probable dans le cas des affaires de diffamation
au pénal et au civil, lorsqu’il y a jury (paragraphe 24).
-
La convention n’est certainement pas une règle (paragraphe 22).
-
Le Parlement ne devrait pas être plus limité dans ses débats, à propos
des instances judiciaires, que ne l’est la presse qui en donne le compte
rendu (paragraphe 22).
-
Tous les députés devraient normalement faire preuve de jugement lorsqu’il
y a risque de préjudice pour des instances. Au cours de la période des
questions, le rôle du président doit être minimal, et la responsabilité
de faire preuve de retenue doit reposer surtout sur le député qui pose
la question et le ministre qui y répond (paragraphe 23).
-
Il serait peu sage de tenter d’encadrer de règles précises l’application
de la convention (paragraphe 24).
-
Le président devrait demeurer l’arbitre ultime, mais il ne devrait intervenir
que dans les cas exceptionnels où il lui semble clair que, s’il ne le fait
pas, il y a risque de préjudice à l’encontre de personnes bien précises
(paragraphe 24).
-
En cas de doute dans l’esprit de la présidence, la présomption devrait
favoriser la tenue du débat plutôt que l’application de la convention (paragraphe
24).
À mon avis, les recommandations du Comité spécial demeurent, 30 ans plus
tard, judicieuses et utiles. Elles devraient toujours constituer le fondement
de toute application de la convention relative aux affaires en instance
au Canada.
Au moins une assemblée législative au Canada a tenté de codifier la convention
dans son règlement. En Ontario, en effet, le paragraphe 23g) du règlement
dit ceci :
Pendant un débat, le président de l’Assemblée rappelle au Règlement le
député qui :
g) fait référence à une question qui fait l’objet d’une instance, selon
le cas :
(i) en cours devant un tribunal ou un juge pour décision judiciaire,
(ii) devant un organe quasi-judiciaire mis sur pied soit par l’Assemblée,
soit en vertu d’une loi de la Législature,
lorsque le président de l’Assemblée est convaincu que pareille référence
risque de porter réellement et gravement atteinte au déroulement de l’instance.
Qu’il s’agisse d’une convention non écrite ou codifiée dans le règlement,
celui qui préside les délibérations parlementaires et adopte les principes
du Comité spécial doit toujours se demander à quel moment au juste il y
a un risque évident de préjudice pour une instance. Souvent, il faut exercer
ce jugement sans préavis et dans le vif du débat. En pareille circonstance,
il y a une tendance naturelle à préférer la sécurité et à déclarer telle
question ou telle observation irrecevable. Mieux vaut prévenir que guérir,
n’est-ce pas?
Peut-être pas. Le souci de sécurité risque de rompre de façon injuste l’équilibre
entre la liberté d’expression au Parlement et l’équité des procès. Voilà
qui va à l’encontre des conseils du Comité spécial, qui a recommandé que,
en cas de doute, la liberté d’expression soit privilégiée. Ces précautions
sont également inutiles parce qu’il existe de bonnes lignes directrices
pratiques : le droit relatif à l’outrage au tribunal.
Immunité parlementaire et outrage au tribunal
À coup sûr, les mieux placés pour savoir quand un préjudice est causé à
des instances judiciaires, ce sont les juges eux-mêmes. Le principal outil
à leur disposition pour prévenir le préjudice et assurer des procès équitables,
c’est l’intervention pour « outrage au tribunal ». Il existe, à cet égard,
un corpus juridique d’importance. C’est de ce côté que peuvent se tourner
ceux qui sont chargés de présider des délibérations parlementaires.
Avant d’entrer dans le détail de la notion d’outrage au tribunal, il importe
de répondre à une objection évidente : pourquoi les parlementaires se soucieraient-ils
d’outrage au tribunal? Les parlementaires ne sont-ils pas totalement à
l’abri de toute poursuite au pénal et au civil, notamment pour outrage
au tribunal, qui découlerait de leurs interventions au parlement?
En réalité, le parlementaire ne jouit pas d’immunité s’il agit d’une arrestation
pour outrage criminel ou quelque autre crime. Cependant, cela ne veut pas
dire qu’il peut y avoir outrage, criminel ou autre, pour des propos tenus
au parlement.
Joseph Maingot a écrit ce qui suit dans son chapitre intitulé « Privilège
de la liberté de parole » :
En 1858, le juge Badgley, saisi d’une question d’élection contestée dans
le Bas-Canada, fit observer que le député Bellingham, qui l’avait accusé
de corruption dans un document écrit, « aurait mieux fait de confiner ses
insultes au parquet du Parlement ou du comité ».
La Cour supérieure du Québec, saisie d’une question d’outrage au tribunal,
a confirmé que tout ce qui est dit au cours des débats est protégé par
l’immunité parlementaire et ne peut faire l’objet d’aucune poursuite devant
les tribunaux3.
Ce dernier passage se rapporte à une cause dans laquelle un ministre fédéral
a sévèrement critiqué un juge après que son ministère avait perdu lors
de poursuites intentées en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les
coalitions. Le ministre a été jugé coupable d’outrage au tribunal en raison
de ses propos, qui avaient été tenus dans un salon des Communes, adjacent
à la Chambre. Le juge a déclaré ce qui suit :
... il est incontestable que tout ce qui se dit dans la salle de la Chambre
des communes ne peut faire l’objet d’aucune instance judiciaire. [...]
Compte tenu du fait que le privilège absolu ne se rattache qu’aux travaux
du Parlement, il me semble presque aller de soi, étant donné les textes
cités plus haut, qu’il ne s’applique pas aux déclarations faites en réponse
aux journalistes dans un lieu prévu à cette fin et qui est distinct de
l’enceinte de la Chambre4.
La décision a été confirmée par la Cour d’appel du Québec5.
La thèse centrale du présent document, c’est que, si les tribunaux ne peuvent
intervenir au parlement pour protéger l’équité d’un procès, la convention
relative aux affaires en instance doit être appliquée lorsque les propos
tenus au parlement feraient l’objet d’une poursuite pour outrage s’ils
avaient été tenus à l’extérieur de la Chambre.
La convention relative aux affaires en instance devient une expression,
fondée sur des principes, de la déférence du parlement à l’égard des tribunaux.
En d’autres termes, il s’agit du pendant parlementaire des règles relatives
à l’outrage au tribunal, mais interprétées et appliquées par les parlementaires.
Outrage au tribunal
L’« outrage au tribunal » se rattache à la compétence inhérente que possèdent
les tribunaux en matière de gestion de leurs propres délibérations. Quiconque
adopte un comportement, à l’intérieur ou à l’extérieur de la cour, qui
menace l’équité d’un procès s’expose à être sanctionné pour outrage. La
personne reconnue coupable d’outrage est passible d’une amende ou même
d’une peine d’emprisonnement.
L’« outrage au tribunal », est le seul crime de droit commun au Canada, c’est-à-dire
qu’il n’est pas codifié dans le Code criminel et que sa portée est déterminée
uniquement par rapport aux usages passés et aux besoins actuels. Le tribunal
s’en occupe directement, sans l’intervention de la police ni des procureurs.
Cette caractéristique de l’outrage au tribunal confère à ce crime un certain
degré d’incertitude : qu’est-ce qui constitue un outrage, au juste?
Pour les parlementaires, une difficulté supplémentaire réside dans le fait
qu’il existe fort peu de précédents de procès pour outrage intentés contre
des parlementaires ou même de cas où un juge s’est inquiété de propos parlementaires.
Il faut chercher des lumières ailleurs.
Heureusement, le Comité spécial de 1977 a proposé une analogie utile et
intéressante :
... elle [la convention] ne devrait être en aucun cas considérée comme
une règle bien établie à laquelle il faudrait se conformer. Il ne serait
pas raisonnable de dire que le Parlement devrait être astreint en ce qui
concerne des commentaires faits en Chambre se rapportant à des procédures
judiciaires, à des restrictions qui ne s’appliqueraient pas à la presse.
À l’instar du Comité spécial, je crois que nous avons beaucoup à apprendre
des journalistes en ce qui concerne la convention relative aux affaires
en instance. Les journalistes se posent à ce propos les mêmes questions
que les parlementaires, mais bien plus souvent, car ils écrivent tous les
jours ou diffusent des textes sur les ondes au sujet des travaux des tribunaux.
En raison du nombre des articles ou reportages, il y a bien plus d’exemples
de poursuites pour outrages contre des journalistes ou des médias. Plus
il y a de précédents, plus il y a d’indications.
Un ouvrage récent du professeur Dean Jobb traite de façon approfondie et
structurée de la question des contraintes qui encadrent le travail des
journalistes6.
Certes, il est impossible de dresser une liste complète de règles sur l’outrage
au tribunal, mais, comme il s’agit d’un crime particulier relevant de la common law, il est possible de dégager des principes généraux des précédents :
-
Le pouvoir judiciaire de sévir contre l’outrage vise à « garder la justice
claire et pure pour que les parties puissent agir avec sûreté pour elles
et ceux qu’elles représentent ».
-
L’outrage peut prendre diverses formes et, notamment, causer un préjudice
à l’une des parties (d’habitude l’intimé, dans les instances pénales),
occasionner des retards ou des dépenses indus, ou donner l’impression d’une
injustice notable.
-
Pour constituer un acte d’outrage, une publication doit « présenter un risque
réel d’ingérence dans l’administration de la justice plutôt qu’une simple
possibilité ». Pour reprendre les mots employés à la Chambre des lords du
Royaume-Uni, « le préjudice doit être plus qu’un élément insignifiant ou
trivial, mais moins qu’une certitude ». Dans le même ordre d’idées, on peut
dire qu’une ordonnance de non-publication ne peut être imposée que si l’information
présente un « risque réel et important » pour la tenue d’un procès équitable,
et les juges doivent limiter la portée de l’interdiction pour garantir
que le public recevra autant d’information que possible sur la cause.
- Comme l’outrage est un crime de droit commun, chaque autorité possède ses
propres normes. Ainsi, certains actes peuvent être considérés comme un
outrage en Alberta et non en Ontario; ou être considérés comme tels en
Ontario, mais non en Nouvelle-Écosse.
- Lorsqu’il s’agit de savoir s’il y a outrage, il faut tenir compte de toutes
les circonstances.
- L’un des facteurs les plus importants est d’ordre temporel : plus on est
près du procès ou du choix des jurés, plus le risque de préjudice est grand.
Si le procès doit avoir lieu dans des années ou même seulement quelques
mois, il n’y a pas de risque réaliste de préjudice. Si le procès est en
cours, le préjudice est plus probable.
- Il existe d’autres facteurs à prendre en considération : y aura-t-il un
jury? Comment l’information est-elle présentée (de manière sensationnaliste
ou équilibrée)? Quels sont les enjeux du procès?
- Il existe pour les journalistes quelques zones floues : supposer qu’un prévenu
est coupable; s’attaquer à la personnalité d’un prévenu; faire état de
condamnations antérieures; dire qu’il y a eu des aveux; montrer des photographies
du prévenu, s’il y a un problème d’identification. L’élément commun est
que les jurés ou ceux qui sont susceptibles de le devenir peuvent être
mis en contact avec une information qui n’est pas admissible devant un
tribunal. Et ce type d’information n’est pas admis justement parce qu’il
est injustement préjudiciable.
- C’est un outrage que de déroger à une ordonnance de non-publication ou
encore d’identifier un témoin ou un prévenu dont l’identité est protégée.
Voilà donc les restrictions qui encadrent le travail des journalistes.
Ce sont en fait exactement les restrictions que les parlementaires s’imposent
lorsqu’ils parlent à l’extérieur de la chambre. Mais qu’en est-il de ce
qui se passe à l’intérieur de la chambre?
Signaux d’alerte pour les présidents de séance
Les règles en matière d’outrage qui s’appliquent aux journalistes s’appliquent
aussi en gros dans l’enceinte parlementaire, mais quelques réserves s’imposent.
Personne ne s’attend que les présidents de séance puissent appliquer le
droit relatif à l’outrage avec précision. La chambre n’est pas une salle
de tribunal, et les présidents de séance et les greffiers au Bureau n’ont
pas à être des juristes. Le droit relatif à l’outrage, comme tout concept
relevant de la common law, évolue sans cesse. Néanmoins, les contours généraux
de ce domaine du droit sont raisonnablement clairs, et son application
n’est pas plus difficile que celle du droit parlementaire que les présidents
de séance et les greffiers au Bureau doivent faire respecter au cours de
toutes les séances.
Il y a aussi la réalité, qu’il ne faut pas se cacher, que les propos des
parlementaires ne font pas, en soi, beaucoup de bruit. Rares sont les auditeurs
qui assistent aux séances; le hansard ne possède pas le lectorat d’un quotidien
local; même la télédiffusion des débats n’a pas la cote d’écoute du bulletin
d’information de l’heure du dîner ou de Star Académie. Pour avoir une influence
sur un groupe de jurés, il faudrait que les propos des parlementaires soient
relayés par les grands moyens de communication. Mais les médias assurent
déjà un filtrage de ces propos en raison des règles relatives à l’outrage.
Ils ne rapportent rien de ce qu’un politicien peut dire qui risque de constituer
un outrage, car ils pourraient eux-mêmes être mis en accusation. Les situations
où une intervention au parlement peut présenter un risque réel et important
de préjudice se résument donc aux rares cas où le parlementaire dit quelque
chose de préjudiciable si quelqu’un en prend connaissance, par exemple
s’il révèle l’identité d’un prévenu ou d’une victime, alors que cette identité
est protégée par un interdit de publication.
Ces réserves une fois faites, il nous est maintenant possible d’énumérer
les « signaux d’alerte » auxquels un président de séance peut être attentif.
Dans aucun de ces cas, le parlementaire ne doit automatiquement se faire
enlever la parole. Il s’agit simplement d’indications montrant que le risque
augmente. La liste ne doit pas non plus être considérée comme exhaustive.
Dans chaque cas, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances.
Voici une liste partielle des « signaux d’alerte » :
- Un procès est imminent ou en cours, et il se déroule avec jury. L’élément
temporel est peut-être le critère le plus critique du point de vue de l’outrage.
- Le député tient des propos sur les caractéristiques personnelles d’un juge
qui entend une cause ou sur la façon dont le juge mène une affaire qui
n’est pas encore close.
- Le député attribue la culpabilité à un intimé nommé au pénal dont le procès
n’est pas terminé ou il tient des propos sur la personnalité du prévenu
(y compris en parlant de condamnations antérieures).
- Le député préconise une décision particulière dans une cause précise dont
l’audition n’est pas encore terminée.
- Le député commence à révéler de l’information qui n’est pas du domaine
public, par exemple des renseignements qui font l’objet d’un interdit de
publication, des précisions sur une audience à huis clos, ou encore l’identité
d’un suspect qui n’a pas été inculpé.
- Le député commence à tenir des propos qui pourraient être considérés comme
de l’intimidation de témoins ou de personnes qui peuvent être appelées
à l’être.
- Le député se reporte à une instance judiciaire dans laquelle lui-même ou
un autre député sont personnellement en cause.
Signaux de « champ libre » pour les présidents de séance
Il y a d’autres situations où, de façon réaliste, les risques de préjudice
pour une instance judiciaire sont minimes ou nuls. Je dirais qu’il s’agit
de signaux de « champ libre », car il faut normalement autoriser les députés
à poursuivre. Toutefois, comme dans le cas des « signaux d’alerte », il ne
faut présumer, dans aucun cas, que la convention relative aux affaires
en instance ne s’applique. Ces signaux de « champ libre » indiquent simplement
que le risque de préjudice est minime. Ici non plus, la liste ne doit pas
être considérée comme exhaustive. Dans n’importe quel cas, il faut tenir
compte de toutes les circonstances.
Étape de l’enquête : On donne parfois à entendre que le parlement ne devrait
pas aborder des questions qui font l’objet d’une enquête policière. (Il
faut ici, bien entendu, prendre soin de distinguer entre la procédure courante
de la police, qui s’abstient de tout commentaire sur ses enquêtes au motif
qu’elles risquent d’être compromises par la divulgation prématurée de renseignements.
Cette façon de faire de la police ne constitue pas, en soi, une raison
pour limiter le débat au parlement.)
Il peut s’agir d’un sage conseil de prudence, mais l’application de la
convention relative aux affaires en instance est presque toujours injustifiée.
(Il faut, bien entendu, prendre soin d’établir une distinction avec le
droit des ministres de refuser, au parlement, de confirmer ou de nier qu’une
enquête est en cours ou que telle personne fait l’objet d’une enquête.
Pour le gouvernement, s’abstenir de commenter représente une bonne politique
d’intérêt public, mais ce n’est pas, en soi, une raison de limiter le débat
au parlement.)
La raison fondamentale, c’est qu’il n’y a, par définition, aucune instance
judiciaire et qu’il n’y en aura peut-être jamais. La seule participation
judiciaire est accessoire, par exemple le fait d’accorder des mandats de
perquisition. Il ne peut y avoir de risque réel et important de préjudice
à une instance judiciaire s’il n’y en a pas, en réalité.
En soi, les enquêtes policières peuvent constituer une importante question
de politique d’intérêt public. Le fait qu’une enquête soit entreprise (ou
non) ou que telle personne fasse l’objet d’une enquête (ou non) peut assurément
donner lieu, de façon légitime, à des observations au parlement. Aucune
personne qui participe à des instances judiciaires — juge, procureur, shérif,
agent de police ou autre — n’est au-dessus des commentaires ou des critiques.
Les parlementaires ont un certain nombre d’autres raisons de répugner à
céder leur droit à la libre expression à cause d’une enquête policière :
- Nous devrions probablement faire davantage confiance à notre police au
lieu de croire que des propos tenus au parlement peuvent la détourner de
son travail. Comme les juges et les procureurs, les forces policières au
Canada peuvent être, de façon justifiable, considérés comme des éléments
fort solides.
- Les enquêtes peuvent prendre des années. Le parlement doit abhorrer limiter
le débat pendant une période indéfinie.
- Une enquête n’aboutit pas forcément à une inculpation.
- La police ne confirme pas toujours qu’une enquête est en cours. Le parlement
devrait tenir à éviter de limiter le débat simplement parce que des spéculations
donnent à penser qu’une enquête est peut-être en cours.
Néanmoins, il est possible d’imaginer des cas où des propos tenus au parlement
présentent un risque réel de préjudice pour une enquête. Dans un cas extrême,
il pourrait arriver qu’un parlementaire veuille profiter de l’immunité
parlementaire pour faire une révélation qui serait criminelle ou tiendrait
de l’outrage si elle était faite à l’extérieur du Parlement, par exemple
le contenu d’une demande scellée de mandat de perquisition ou encore l’existence
ou l’identité d’un enquêteur infiltré ou d’un informateur confidentiel.
Il est à peine imaginable qu’un parlementaire veuille se comporter de la
sorte ou que cela soit pertinent dans un débat sur une politique d’intérêt
public. Aucun média ne publierait ou ne diffuserait pareille révélation,
car il s’exposerait à des sanctions. Il demeure que cela peut se produire,
et ce serait le moment d’invoquer la convention relative aux affaires en
instance ou à un mécanisme analogue.
Système de justice civile : Un tribunal « civil », c’est, en somme, tout tribunal
qui n’est pas pénal. Le plus souvent, le tribunal civil arbitre des différends
entre des intérêts privés.
Aux fins de la convention relative aux affaires en instance, il y a trois
grandes différences entre les causes pénales et civiles. Et toutes ces
distinctions tendent à faire diminuer la nécessité de recourir à la convention
dans le cas des causes civiles.
D’abord, au Canada, la très grande majorité des procès au civil se tiennent
sans jury. On peut donc laisser de côté la question de l’influence qui
pourrait s’exercer sur les candidats jurés ou les jurés eux-mêmes.
Dans certaines provinces, les procès pour libelle ou diffamation se déroulent
devant jury, à moins que les parties ne s’entendent pour qu’il en aille
autrement. Cela tombe sous le sens, car l’essence d’une action en diffamation
est l’effet sur le public des déclarations présentées comme diffamatoires.
Le problème réside dans le fait que les actions en diffamation peuvent
être intentées précisément pour paralyser le débat public sur certains
projets. C’est un phénomène qu’on appelle couramment « poursuite stratégique
contre la mobilisation publique ».
Les parlementaires devraient prendre soin de ne pas paralyser leur propre
débat lorsque c’est précisément l’un des buts que le plaignant vise en
intentant une action.
La deuxième grande différence entre le civil et le pénal, c’est que la
vaste majorité des actions au civil n’aboutissent jamais à un procès. Alors
que seule une infime partie des causes pénales se terminent par un retrait
des accusations, tout avocat qui plaide au civil confirmera qu’au moins
90 p. 100 des poursuites, et plus vraisemblablement de 95 à 98 p. 100, se
règlent ou sont abandonnées avant l’étape du procès.
Troisièmement, il s’écoule souvent des années entre le moment où l’action
est intentée et le procès ou encore le retrait ou le rejet de l’action.
À la différence de ce qui se passe au pénal, il n’y a aucune garantie constitutionnelle
du droit à un procès rapide au civil. Le parlement devrait se garder de
limiter le débat sur une question pour laquelle le procès tardera pendant
des années, à supposer qu’il ait jamais lieu.
Pour ces raisons, on doit s’attendre que la convention relative aux affaires
en instance soit invoquée bien plus rarement pour les affaires civiles
que pour les causes pénales. Même dans les causes extrêmement rares où
il y aura un jury au civil, on n’a pas à tenir sérieusement compte du préjudice
— tout comme dans les procès au pénal — tant que le procès n’est pas imminent
ou en cours. Le point crucial, le plus souvent, est le moment où l’affaire
est « inscrite au rôle », c’est-à-dire quand le plaignant fait savoir officiellement
qu’il est prêt pour le procès. Lorsqu’il y a inscription au rôle, il est
plus probable, bien que ce soit encore loin d’être certain, qu’un procès
aura effectivement lieu.
Commissions royales et enquêtes publiques : Il y a eu quelque discussion
entre les autorités sur l’application de la convention dans le cas des
commissions royales et d’autres formes d’enquêtes publiques.
Alors que les auteurs anciens semblent divisés, un consensus semble se
dessiner chez les modernes pour dire que la convention s’applique, en principe,
aux commissions et aux enquêtes publiques. La question centrale est celle
de savoir si le discours tenu au parlement présente un risque réel et important
de préjudice pour la commission ou l’enquête. C’est là le même critère
que celui des poursuites dans les tribunaux ordinaires.
Nous devrions cependant nous attendre que la convention ne s’applique que
rarement aux commissions et aux enquêtes, la principale raison étant qu’il
s’agit précisément d’enquêtes. Ce ne sont pas des instances judiciaires
dont l’enjeu est la culpabilité pénale ou la responsabilité civile. Les
objectifs diffèrent de ceux des tribunaux. En outre, les enquêtes publiques,
par leur nature même, comportent un élément d’intérêt public. On ne peut
souhaiter écarter le débat parlementaire, peut-être pendant des années,
lorsqu’il s’agit d’un enjeu de politique d’intérêt public qui est jugé
assez important pour justifier une enquête publique. En outre, la préoccupation
principale des systèmes de justice pénale et civile, soit la protection
des jurys contre toute influence indue, est tout à fait absente des enquêtes
publiques.
Il peut arriver qu’on ait des motifs de craindre l’intimidation de témoins
ou la divulgation de renseignements que le commissaire chargé de l’enquête
a recueillis à huis clos ou dont il a interdit la publication. Comme toujours,
l’approche la mieux ancrée sur des principes consiste à suivre un raisonnement
analogue à celui qui est tenu dans le cas d’un outrage au tribunal, en
tenant compte, comme il se doit, des différences qui existent entre les
tribunaux ordinaires et les enquêtes publiques, par exemple l’absence de
jury.
Le président de la Chambre des communes britannique a tenté d’établir une
distinction entre les commissions royales qui s’intéressent à la conduite
de personnes en particulier et les commissions royales qui étudient des
« questions plus vastes, d’une importance nationale ». La convention relative
aux affaires en instance s’appliquerait dans le premier cas, mais pas dans
le deuxième. Je ne suis pas convaincu de l’utilité de cette distinction,
car, le plus souvent, les enquêtes publiques ne se rangent nettement ni
dans une catégorie ni dans l’autre. Par exemple, une enquête publique récente
en Nouvelle-Écosse découlait d’une collision mortelle qui mettait en cause
un jeune contrevenant qui aurait dû être sous garde. Le rapport d’enquête
a présenté à la fois une étude soignée des faits et des recommandations
plus générales au sujet des jeunes à risque. Dans quelle catégorie faudrait-il
ranger cette enquête? Au fond, il est impossible de le dire, et il est
inutile d’essayer.
Appels: Il existe, surtout au Royaume-Uni, des textes faisant autorité
qui appuient l’application de la convention à l’étape des appels interjetés
au sujet d’actions judiciaires. Le Comité spécial de la Chambre des communes
du Canada, en 1977, n’a pas abordé la question directement. Si l’on reste
fidèle à l’analyse que j’ai élaborée, la convention ne devrait pas s’y
appliquer, et cela, pour deux raisons.
D’abord, il n’y a dans les appels ni jury, ni témoins, ni nouveaux éléments
de preuve. Les appels sont toujours entendus par des juges seulement. En
fait, les cours d’appel sont généralement composées des meilleurs juges,
de ceux qui ont le plus d’expérience. On peut même soutenir que, dans tout
l’appareil judiciaire, les juges d’appel sont les moins susceptibles de
se faire influencer par des propos tenus au parlement. Par conséquent,
où se trouve au juste le « risque réel et important de préjudice » qui est
censé justifier le recours à la convention relative aux affaires en instance?
Je ne vois pas.
Deuxièmement, les appels peuvent parfois prendre des années, surtout si
une cause est soumise à la Cour d’appel ou même à la Cour suprême du Canada.
Il y a lieu de se demander s’il y a un juste équilibre dans une situation
où le parlement s’interdit pendant des années de parler d’un sujet donné.
Il me semble beaucoup plus sensé de mettre fin au recours à la convention
lorsque la partie du procès où la preuve est recueillie est terminée ou,
s’il y a jury, au moment où celui-ci est libéré. Dans les rares cas où
un appel est accueilli et un nouveau procès ordonné, la convention peut
s’appliquer de nouveau, suivant les principes utilisés au départ.
Signaux incitant à la prudence pour les présidents d’assemblée
Le système de justice administrative est une zone aux contours indécis.
Il regroupe une vaste gamme d’organismes, d’offices, de commissions et
de tribunaux qui ont le pouvoir de recevoir des éléments de preuve et de
rendre des décisions ayant une incidence sur les droits et les obligations
des citoyens. Étant donné le nombre considérable de ces organes décisionnaires,
il est tout simplement impossible d’énoncer des règles générales susceptibles
de s’appliquer à tous. Certains tribunaux se rapprochent fort des tribunaux
de justice par leur structure, leurs méthodes et leurs pouvoirs. D’autres
organes ont des fonctions de réglementation ou de consultation, leurs membres
sont rémunérés ou non, leur travail a un caractère officiel ou officieux,
le personnel possède une formation ou non, l’entité a un personnel ou n’en
a pas.
Il est carrément impossible de voir clairement si la convention s’applique
dans le cas de la justice administrative et comment elle peut le faire.
Aucun tribunal n’a en commun avec les tribunaux supérieurs le pouvoir inhérent
de sévir contre l’outrage. Par conséquent, tout effort en vue de traiter
la convention relative aux affaires en instance comme un prolongement parlementaire
de la compétence à l’égard de l’outrage, thèse que j’ai défendue dans ces
pages, échoue immédiatement.
Des observateurs ont tenté d’aborder la question en introduisant une distinction
entre les tribunaux qui sont des « cours d’archives » et ceux qui ne le sont
pas. La convention s’appliquerait aux « cours d’archives ». Le problème,
c’est que l’expression « cour d’archives » est vague et désuète. Devant tel
ou tel tribunal, il est impossible de dire s’il s’agit ou non d’une « cour
d’archives ». Cette distinction n’est d’aucune utilité.
Le paragraphe 23g) du Règlement de l’Assemblée législative ontarienne tente
d’établir le même genre de distinction. Il parle de tribunaux « quasi judiciaires ».
La même critique est de mise : ce qualificatif est imprécis, et il est maintenant
plutôt dépassé. Il n’est pas toujours évident que tel tribunal est « quasi
judiciaire » ou non. Le mieux que nous puissions dire, c’est que, plus un
tribunal ressemble à une cour de justice et se comporte comme elle, plus
il est probable qu’il est « quasi judiciaire ».
Malgré ces difficultés d’application dans tel ou tel cas, il semble clair,
selon les autorités, que la convention relative aux affaires en instance
doit s’appliquer aux tribunaux administratifs, parce qu’ils font partie
du système de justice.
Je soutiendrais même que la menace de préjudice risque d’être plus grande
dans le cas d’instances de la justice administrative que dans des procès
au pénal ou au civil. C’est que, dans le cas des procès au pénal ou au
civil, l’indépendance des juges est protégée par la Constitution et est
renforcée par des dispositions relatives à la rémunération, au mandat et
aux conditions de travail qui mettent les juges, pour ainsi dire, à l’abri
des soucis matériels. Ils possèdent également des outils de procédure puissants
et le pouvoir de sévir contre les outrages.
En revanche, les membres des tribunaux administratifs ont, le plus souvent,
un mandat bien plus bref et une rémunération très inférieure, et ils ne
disposent pas du pouvoir de sanctionner ni même de réprimander quiconque
n’est pas l’une des parties en présence. Ils sont nommés par le gouvernement
et peuvent être redevables au gouvernement de la reconduction de leur mandat,
de leur financement et de leurs conditions de travail. S’il est quelqu’un
qui risque d’être influencé par des propos critiques au parlement, c’est
plus probablement au niveau des tribunaux administratifs que des tribunaux
de justice.
Par ailleurs, il y a un nombre considérable d’instances administratives
qui se déroulent en même temps à n’importe quel moment donné, et une application
trop large de la convention relative aux affaires en instance mettrait
hors du champ des débats parlementaires des pans entiers de la politique
d’intérêt public.
Il ne faut pas oublier non plus que la majeure partie des instances administratives,
ainsi que les propos parlementaires qui s’y rapportent, ne reçoivent aucune
publicité, que la quasi-totalité de ces instances comportent un élément
d’intérêt public qui en font des sujets auxquels les parlementaires peuvent
légitimement s’intéresser; que ce qui est en jeu n’est pas, d’habitude,
aussi important que dans un procès au pénal; qu’il n’existe pas d’équivalent
administratif du jury, dont la protection contre les influences injustes
constitue l’un des objectifs principaux de la convention relative aux affaires
en instance.
Options offertes aux présidents de séance en matière de procédure
Un président de séance qui remarque un des « signaux d’alerte » a à sa disposition
un certain nombre d’options en matière de procédure qui lui permettent
de contenir le risque de façon satisfaisante, sans avoir à recourir à la
solution radicale qui consiste à enlever la parole au député.
Chose certaine, le président de séance voudra d’abord avertir le député,
car nous pouvons présumer sans crainte qu’aucun député ne veut délibérément
porter préjudice à une instance judiciaire. Une fois informés du risque,
la plupart des députés s’empresseront de revoir leur façon d’aborder la
question ou de reformuler leur intervention.
Il y a d’autres options, selon les circonstances. Le président peut permettre
à un témoin de ne pas répondre ou déclarer le huis clos (dans le cas d’un
comité), ou encore faire une brève pause pour avoir une discussion officieuse
avec le député au sujet de ses intentions. Selon la nature du débat, le
président de séance peut aussi demander au député s’il est disposé à reporter
à un autre moment ses propos sur la question pour que la présidence ait
le temps de se renseigner sur les faits entourant une instance judiciaire
donnée.
Si un président de séance entend des propos qui, d'après lui, présentent
un risque réel et important de préjudice, mais s’il a été incapable d’interrompre
le député à temps, il a la possibilité de faire rayer ces propos du compte
rendu, de façon qu’il ne reste pas de trace écrite permanente des propos
qui portent préjudice.
Pour trouver le juste équilibre entre la liberté d’expression des parlementaires
et l’équité des procès, il est raisonnable de s’attendre que le président
n’enlève la parole au député qu’en dernier recours, paralysant ainsi tout
débat sur la question.
Deux exemples récents d’application de la convention
Prenons maintenant les principes et les orientations proposés et appliquons-les
à deux cas, l’un en Ontario et l’autre en Nouvelle-Écosse, où la convention
a été invoquée.
En 2006, un député provincial de l’Ontario a tenu à l’extérieur de l’Assemblée
législative des propos exprimant sa très vive opposition à la possibilité
que la négociation de peine dans une affaire pénale particulière comporte
une ordonnance de dédommagement, c’est-à-dire le versement d’un certain
montant à la victime par les défenseurs. Sauf erreur, le point essentiel
de la position du député était qu’un criminel qui a de l’argent ne devrait
pas pouvoir « acheter » une peine plus légère en payant la victime. Le député
était certainement favorable à l’indemnisation par d’autres moyens, comme
le régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels.
Une plainte a alors été formulée aux termes de la
Loi sur l’intégrité des
députés. Cette plainte disait que le député avait violé la convention relative
aux affaires en instance et avait donc manqué à la Loi sur l'intégrité
des députés. Dans son rapport du 25 octobre, le commissaire à l’intégrité
a fait droit à la plainte, mais il a recommandé qu’aucune sanction ne soit
imposée, recommandation qui a été appuyée par un vote majoritaire à l’Assemblée
législative.
J’avoue que, pour diverses raisons, la décision du commissaire me plonge
dans une profonde perplexité :
- Le député a tenu ses propos à l’extérieur de l’Assemblée législative. Par
définition, la convention ne peut donc pas s’appliquer. Le Règlement de
l’Assemblée, comme le texte lui-même le précise, ne s’applique qu’à ce
qui se passe à l’Assemblée législative. Comment un député provincial peut-il
manquer au Règlement si son intervention a lieu à l’extérieur de l’Assemblée
législative?
- Le rapport du commissaire à l’intégrité semble citer le Règlement de façon
erronée. Le Règlement exige qu’on établisse non seulement qu’il y a une
instance judiciaire en cours, mais aussi que l’intervention « risque de
porter réellement et gravement atteinte au déroulement de l’instance ».
Le commissaire à l’intégrité s’est demandé seulement si une instance judiciaire
était en cours (ce qui était le cas). Il ne s’est aucunement demandé si,
en l’espèce, les propos du député risquaient « de porter réellement et gravement
atteinte au déroulement de l’instance ».
- Le commissaire à l’intégrité signale que les propos du député n’ont pas
eu, en fait, quelque incidence que ce soit sur la négociation de plaidoyers
ni sur la peine imposée par le juge. Je présume que la plupart des procureurs
nieraient tout à fait que leur jugement ait pu être influencé par autre
chose que des considérations professionnelles. La conduite d’un procureur
est régie par une jurisprudence bien établie, la politique ministérielle
et des normes professionnelles. Dans certaines provinces, le service des
poursuites est officiellement indépendant du gouvernement.
- Comme le commissaire à l’intégrité le signale, les tractations avaient
lieu entre le procureur du ministère public et l’avocat de la défense,
sous la surveillance d’un juge d’expérience. Si le juge avait éprouvé quelque
crainte pour l’équité du déroulement de l’instance, il aurait pu citer
le député pour outrage. La plainte formulée aux termes de la Loi sur l’intégrité
des députés est venue d’un autre député provincial (comme cette loi le
prévoit), agissant, semble-t-il, à la demande de la victime et de son avocat.
Il se peut que la victime, dans ce cas particulier, ait eu le droit d’être
mécontente, voire scandalisée par les propos du député. Certains seront
peut-être même d’avis que les propos du député étaient peu judicieux, étant
donné que la possibilité d’une ordonnance de dédommagement est prévue par
le Code criminel, et que les ordonnances de cette nature sont loin d’être
rares. Néanmoins, l’application de la convention relative aux affaires
en instance dans ces circonstances a pour effet d’interdire toute discussion,
même à l’extérieur de l’Assemblée législative, des transactions en matière
pénale, qui sont un sujet légitime de discussion sur la politique d’intérêt
public. En toute déférence, j’estime qu’il s’agit là d’un élargissement
injustifié de l’application de la convention relative aux affaires en instance.
Une autre affaire, en Nouvelle-Écosse cette fois, concerne la mise en exploitation
controversée d’une carrière dans le comté de Digby, facteur qui a joué
dans l’élection d’un nouveau député provincial aux élections générales
d’août 2003. Le nouveau député s’opposait à l’exploitation de la carrière.
En octobre 2003, le promoteur a présenté deux poursuites en diffamation
dont les intimés étaient un simple citoyen, le journal local, le propriétaire
du journal et un journaliste. Le journal avait publié un article dans lequel
était cité un citoyen qui alléguait certaines fautes de la part de l’entreprise.
Le nouveau député a pris la parole à l’Assemblée le 22 octobre 2003, au
cours de la période des questions, et a demandé ce que le premier ministre
entendait faire pour protéger le droit à la libre expression des habitants
de Digby. Le président a déclaré la question irrecevable au motif que les
tribunaux étaient saisis de l’affaire.
À la fin de la période des questions, le leader à la Chambre du député
en question a invoqué le Règlement, demandant au président de se prononcer
sur l’application, à des instances civiles, de la convention relative aux
affaires en instance. Le lendemain, le président a rendu une décision officielle,
disant que la convention pouvait s’appliquer aux instances civiles aussi
bien que pénales. Il a signalé que les poursuites en diffamation en Nouvelle-Écosse
étaient entendues par un jury. En conséquence, il a statué qu’il avait
eu raison de juger la question irrecevable8.
En toute déférence, j’estime que cette décision présente plusieurs problèmes.
Selon le rapport du Comité spécial de 1977, que le président a cité dans
sa décision, la convention relative aux affaires en instance ne devrait
s’appliquer que dans des cas exceptionnels, là où le risque de préjudice
est clair. En outre, le Comité spécial a recommandé que la convention ne
soit presque jamais invoquée pendant la période des questions. Enfin, il
a recommandé qu’il incombe à celui qui veut restreindre le débat d’établir
qu’il y a eu préjudice. Dans ce cas, c’est le président lui-même qui a
invoqué la convention, sans qu’aucune objection (au moins d’après le compte
rendu) ne se soit élevée du côté du gouvernement.
La décision du président fait grand cas du fait que, en Nouvelle-Écosse,
les procès en diffamation se déroulent avec jury. Or, la décision du président
n’a tenu aucun compte du fait que les poursuites ne remontaient qu’à quelques
jours. Par conséquent, le choix des jurés allait tarder pendant des années,
pour peu que l’affaire fasse jamais l’objet d’un procès.
Avec le recul, nous savons maintenant que le plaignant n’a pris aucune
autre mesure pour faire avancer le dossier. Les poursuites ont été officiellement
abandonnées, à la fin de 2005 dans un cas et au début de 2006 dans l’autre.
C’est d’habitude le signe que les parties sont parvenues à un règlement.
Ces affaires ne donneront jamais lieu à un procès.
Conseil pratique pour les députés : la modération
Ce serait négligence de conclure sans donner le conseil le plus pratique :
tous les problèmes de la convention relative aux affaires en instance peuvent
se résoudre si les parlementaires font preuve d’une certaine modération
dans leur approche des instances judiciaires.
Les parlementaires doivent faire preuve de modération parce que le préjudice
peut être causé avant qu’un président de séance ne puisse intervenir.
Les parlementaires doivent également se rappeler que tout ce qui peut être
considéré comme outrage, si les propos sont tenus à l’extérieur du parlement,
n’est probablement pas une contribution utile au débat, si les propos sont
tenus à l’intérieur du parlement.
Le scénario le plus probable est que le parlementaire, dans le feu de l’action,
s’avancera accidentellement en terrain dangereux. En pareil cas, lorsqu’il
s’agit vraiment d’un accident, un avertissement du président de séance
devrait suffire à inciter le député à repenser ou à reformuler ses propos
de façon à les rendre plus acceptables.
Dans les cas où il ne s’agit pas d’un accident, le député ferait bien de
prévenir le président de séance qu’il parlera d’une instance judiciaire.
Cela donne au président de séance une importante marge de manœuvre, c’est-à-dire
du temps pour réunir les faits de façon qu’il soit en bonne position afin
de juger s’il y a un risque réel et important de préjudice pour l’instance
judiciaire.
Le président de séance dispose peut-être de certaines options en matière
de procédure si un problème d’application de la convention surgit à l’improviste.
Il peut (surtout dans un comité) en avoir d’autres, par exemple déclarer
le huis clos, faire une brève pause pour se renseigner officieusement auprès
du député, ou permettre à un témoin de ne pas répondre à une question.
Si le député s’entête et si le président de séance est persuadé que la
déclaration constituerait un outrage au tribunal si elle était faite à
l’extérieur de la Chambre, il est possible d’invoquer la convention relative
aux affaires en instance et d’enlever la parole au député.
Si les présidents de séance ont une idée réaliste du comportement qui constitue
un outrage et si les députés font preuve d’une certaine modération, il
devrait arriver très rarement qu’on invoque la convention relative aux
affaires en instance.
Notes
1. Voir Marleau et Montpetit,
La procédure et les usages de la Chambre
des communes, Ottawa, Chambre des communes, p. 104.
2. Voir Canada, Chambre des communes, Journaux, 29 avril 1977, p. 720-729.
Ce rapport a suivi un excellent article de Phillip Laundy, « The Sub Judice
Convention in the Canadian House of Commons », dans The Parliamentarian,
vol. 57, no 3 (juillet 1976). L’auteur signalait qu’aucun effort n’avait
été fait jusque là pour codifier la pratique concernant la convention relative
aux affaires en instance.
3. Voir Joseph Maingot, Le privilège parlementaire au Canada, 2e éd., p.
31 et 33.
4. Re Ouellet (no 1) (1976), 67 D.L.R. (3e) 73 (C.S. du Québec), p. 85-87.
5. Re Ouellet (nos 1 et 2) (1976), 72 D.L.R. (3e) 95 (C.A. du Québec).
6. L’essentiel de la section qui suit, portant sur le droit relatif à l’outrage,
est une paraphrase du chapitre 5 de Jobb, « Contempt of Court ». M. Jobb
est un ancien journaliste qui est actuellement professeur de journalisme
à l’Université King’s College, à Halifax.
7. Voir « Application of the Sub Judice Convention », dans
The Table, volume
64 (1996), p. 92. On y consigne une décision rendue par le président de
la Chambre des communes du Royaume-Uni le 27 juin 1994.
8. Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse,
Hansard, 22 octobre 2003,
p. 1480-1481 (question) et p. 1501-1502 (rappel au Règlement); 23 octobre
2003, p. 1571-1572 (décision du président).
|