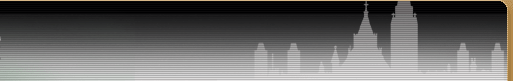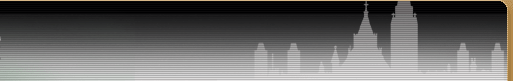|
PDF
Les
États-Unis sont l'unique point de comparaison auquel se réfèrent généralement
les Canadiens pour mesurer leurs succès ou leurs insuccès économiques. Il existe
pourtant d'autres pays qui ont éprouvé, ou qui éprouvent toujours, des
difficultés économiques, et les mesures qu'ils ont prises pour surmonter ces
difficultés pourraient peut-être présenter de l'intérêt pour les Canadiens. La
Nouvelle-Zélande en est un exemple. On trouvera, ci-après, une entrevue sur
l'histoire économique récente de la Nouvelle-Zélande que nous a accordée un
ex-ministre néo-zélandais. Originaire d'Auckland, Michael Bassett a fait des
études à l'université d'Auckland et à l'université Duke aux États-Unis. Il a
siégé au Parlement de la Nouvelle-Zélande de 1972 à 1975 et de 1984 jusqu'à sa
retraite, en 1990. Après l'élection du gouvernement travailliste en 1984, on
lui a confié le portefeuille de la Santé, de 1984 à 1987, et le ministère des
Administrations locales, de 1984 à 1990. Historien de profession, M. Bassett
est expert-conseil pour son propre compte depuis 1990 et il a passé l'année
dernière au Canada à titre de professeur invité. Gary Levy l'a interviewé en
avril 1993.
Comment
décririez-vous l'expérience économique et politique néo-zélandaise devant un
auditoire canadien?
La
Nouvelle-Zélande a une très longue tradition d'aide sociale qui remonte à
l'époque du gouvernement libéral de 1891-1912. Le Parti travailliste
(1935-1949) et le Parti national (ou conservateur), qui a dirigé le pays
pendant 29 des 35 années suivantes, ont tous deux contribué à donner encore
plus d'expansion à l'État providence. Il n'est pas faux de dire que, sous bien
des rapports, l'appétit des Néo-Zélandais pour les mesures sociales a pris le
pas sur leur capacité de production. Je ne parle pas uniquement de l'aide
sociale directe, mais de toute une pléthore de mesures indirectes, dont les
contrôles à l'importation et les subventions à l'exportation. Au cours des
années 60, la Nouvelle-Zélande a commencé finalement à ressentir le poids de
ces mesures et elle a vainement tenté de s'adapter aux forces du marché, mais
sans grand succès. Dès 1970, l'OCDE disait que l'économie de la
Nouvelle-Zélande était la plus réglementée du monde à l'exception de celles des
pays communistes. Certains sont allés jusqu'à qualifier la Nouvelle-Zélande de
« Pologne sans les troupes » en parlant de sa situation économique.
La dette, qui avait augmenté en flèche entre 1974 et 1984, atteignait alors
quelque 35 milliards de dollars pour une population de trois millions
d'habitants au plus. Vingt pour cent des recettes fiscales servait uniquement à
éponger l'intérêt de cette dette. Nous étions littéralement obligés d'emprunter
pour payer la note d'épicerie.
Qu'est-il
arrivé en 1984?
Le
premier ministre Muldoon, du Parti national, s'était révélé un maître dans
l'art de la manipulation économique. Sous son gouvernement, des mesures comme
les contrôles des salaires et des prix, l'accroissement des subventions, le
maintien artificiel des taux d'intérêt et ainsi de suite se sont toutes soldées
par un échec. M. Muldoon a fini par perdre sa majorité parlementaire et,
plutôt que de présenter un dernier budget, affichant un déficit de l'ordre de
cinq milliards de dollars, il a décidé de déclencher des élections. Il a été
battu et le nouveau gouvernement travailliste s'est retrouvé avec un immense
gâchis sur le bras. On s'est rué sans tarder sur le taux de change. Le lundi
qui a suivi l'élection, le marché des changes a fermé ses portes, et le nouveau
cabinet - qui, chez nous, est élu par le caucus du parti gouvernemental – s'est
réuni. Nous avons demandé au premier ministre sortant de décréter sur-le-champ
une dévaluation de 20 p. 100 de la devise néo-zélandaise. Nous avons ensuite
commencé à démanteler le vaste mécanisme de soutien construit au fil des ans.
Certains ministères comme ceux des Forêts, des Chemins de fer et des Mines ont
été constitués en société, ce qui signifiait qu'ils devaient commencer à
fonctionner comme des entreprises privées, sans subventions gouvernementales.
Cette mesure a entraîné d'énormes compressions d'effectifs. Par exemple, les
Chemins de fer employaient 22 000 personnes en 1984. Quatre ans plus tard,
ils avaient ramené cet effectif à 8 500 employés sans pour autant réduire
de beaucoup le service-voyageurs ou le service-marchandises. Ces dispositions,
combinées à d'autres initiatives, nous ont permis de présenter alors un budget
déficitaire de 1,5 milliard de dollars (comparativement au déficit anticipé de
cinq milliards, au moment de notre élection). En 1985, nous avons laissé notre
devise flotter et nos taux d'intérêt s'élever.
Quelle
était la situation en ce qui concerne les soins de santé, votre secteur?
L'instauration
de la médecine d'État s'est faite très progressivement en Nouvelle-Zélande.
Entre 1938 et 1946, on a petit à petit assuré l'accessibilité des hôpitaux et
des maternités et la gratuité des produits pharmaceutiques, des rayons X, des
services pathologiques, des soins ambulatoires, des services infirmiers de
quartier et des soins dentaires jusqu'à l'âge de 16 ans. La consultation de
généralistes n'était pas gratuite, cependant. L'État payait 75 cents pour une
consultation qui, dans les années 30, coûtait environ 1,00 $. Dans les années
60, un certain nombre de problèmes s'étaient développés. La construction
d'hôpitaux privés n'étant pas illégale, un régime de soins de santé parallèle
s'était peu à peu établi. Les listes d'attente des hôpitaux publics, dont l'accès
était gratuit, étaient longues. En 1990, la Southern Cross a offert un
plan d'assurance-maladie privé couvrant 80 p. 100 des honoraires des
omnipraticiens, ce qui a aussi favorisé la naissance d'un système de médecine
parallèle. Dans l'intervalle, l'écart entre la part du coût des consultations
médicales générales assumée par l'État et le montant de ces consultations
s'était élargi, et chaque fois que le gouvernement augmentait la participation
de l'État, les médecins en profitaient pour majorer leurs honoraires. Ainsi,
les soins de santé devinrent de moins en moins accessibles aux plus pauvres de
la société.
Quelle
politique avez-vous poursuivie en tant que ministre de la Santé?
Le rythme
des dépenses dans ce ministère était insoutenable. Nous avons donc réduit
certaines dépenses, comme les subventions aux hôpitaux. Nous avons également
mis sur pied une commission chargée d'examiner le régime de soins de santé,
mais lorsque cette commission a présenté son rapport, j'exerçais d'autres
fonctions au sein du gouvernement. Les différents ministres qui ont suivi –
tant dans le gouvernement travailliste que, après les élections de 1990, dans
le gouvernement national – ont été obligés de pratiquer d'autres compressions.
La facturation partielle des produits pharmaceutiques a été instaurée et
l'administration des services a été rationalisée. Il n'est pas faux de dire
que, depuis le changement de gouvernement en 1990, le principe de
l'universalité n'existe plus dans le régime de soins de santé en
Nouvelle-Zélande. Le ticket modérateur est en vigueur maintenant, même dans les
hôpitaux publics. Les frais sont fonction des moyens du client et les cartes
d'assurance-maladie sont délivrées selon le montant du revenu. Par exemple, les
gens gagnant moins de 16 000 $ par année ont droit à la gratuité des soins
médicaux. Des frais modérateurs sont exigés dans la catégorie de revenus allant
de 16 000 $ à 33 000 $. Ceux qui gagnent davantage doivent payer intégralement
la plupart des services médicaux, sous réserve de certaines dispositions
limitatives.
Pourrions-nous
envisager le même scénario au Canada?
Je ne
connais pas en détail le régime de soins de santé du Canada, mais il comporte
certains avantages, il me semble. Par exemple, je crois que le Canada est le
seul pays où les médecins ont, en acceptant d'en négocier le montant avec le
gouvernement, renoncé à leur droit de fixer leurs honoraires. Or, en
Nouvelle-Zélande, ils ont conservé intégralement le droit de décider du montant
à imposer pour leurs consultations. Selon eux, ce que le gouvernement choisit
de rembourser, c'est son affaire. Bref, le droit aux dépassements d'honoraires
est solidement enraciné en Nouvelle-Zélande. On ne peut pas dire non plus que
ce système soit avantageux pour les patients ou les contribuables car, chaque
fois que le gouvernement relève sa participation au régime, les médecins
augmentent leurs honoraires et le consommateur n'est pas plus avancé. C'est de
l'argent jeté par les fenêtres.
Existe-t-il
d'autres points de comparaison entre la politique néo-zélandaise et la
politique canadienne?
La
Nouvelle-Zélande a adopté en 1987 une taxe sur les produits et services de 10
p. 100. Même si cette mesure a suscité de l'opposition, j'ai l'impression
qu'elle a été moins mal accueillie qu'au Canada. C'est peut-être parce que nous
faisons les choses un peu différemment en Nouvelle-Zélande. D'un même souffle,
nous avons adopté la TPS et réduit les impôts, et nous nous sommes efforcés
alors d'expliquer aux contribuables que c'était une nouvelle façon d'aborder la
fiscalité. Nous voulions que le poids de l'impôt porte
davantage du côté des dépenses que du côté des revenus. En outre, notre TPS est
universelle. Aucune exception n'est prévue pour les aliments ni pour autre
chose, ce qui est très important à mon avis. Dès que l'on fait des exceptions,
on ouvre la porte aux groupes d'intérêt spéciaux. C'est vrai qu'une telle
mesure fiscale est très préjudiciable aux moins nantis, mais nous avons relevé
les allocations sociales en conséquence. J'ajouterai pour finir que nous avons
interdit de fixer des prix sans inclure le montant de la TPS pour éviter que le
client ne se retrouve à la caisse avec une facture de 10 p. 100 supérieure à ce
qu'il avait prévu. Nous avons ainsi réussi à désamorcer le sentiment
d'hostilité envers la TPS, qui est maintenant largement acceptée au sein de la
population.
Quel a
été le plus grand moment de votre vie en politique?
C'est
difficile à dire, car la politique a toujours fait partie de ma vie. Et je ne
parle pas uniquement des années que j'ai passées au Parlement. J'ai eu cette
chance unique de pouvoir étudier aux États-Unis à la fin des années 60, lorsque
le mouvement contre la guerre du Vietnam était en pleine fermentation. J'ai pu
observer de près la lutte pour l'intégration raciale dans le sud. À mon retour
en Nouvelle-Zélande, j'ai été élu au conseil municipal d'Auckland, j'ai
enseigné l'histoire politique à l'université d'Auckland de 1964 à 1972 et de
1976 à 1978. J'ai agi à titre d'expert-conseil pour le compte de la
Nouvelle-Zélande à Séville, en Espagne, pendant l'Exposition de 1992. Je
travaille actuellement à plusieurs projets, notamment à la rédaction d'un livre
sur un ancien premier ministre de la Nouvelle-Zélande. Cependant, je suppose
que le point culminant de ma vie en politique a été mon séjour à la direction
du ministère des Administrations locales, entre 1987 et 1990. Lors de
l'élection du gouvernement travailliste, il existait plus de 800
administrations locales, les administrations de comté, de municipalité, de
rivières, bref de tout ce qui peut exister. En 1989, nous avions réussi à
réduire ce nombre à 93 conseils électifs de région et de district. Les
gouvernements précédents avaient fait état de la nécessité de consolider le
gouvernement local, mais ils ont tous fait marche arrière devant les pressions
venant de divers groupes d'intérêt. Notre gouvernement et mon ministère ont
réussi à effectuer cette consolidation, et c'est probablement pour cette mesure
surtout qu'on se souviendra de moi dans les milieux politiques néo-zélandais.
|